-
AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE

UNIÃO AFRICANA
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
MAMADOU DABO ET AUTRES
C.
RÉPUBLIQUE DU MALI
REQUÊTE N° 027/2017
ARRÊT
1er DÉCEMBRE 2022
SOMMAIRE
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 6
A. Exception tirée du non-épuisement des recours internes 11
B. Autres conditions de recevabilité 17
La Cour, composée de : Imani D. ABOUD, Présidente, Blaise TCHIKAYA, Vice-président ; Ben KIOKO, Rafaâ BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Stella I. ANUKAM, Dumisa B. NTSEBEZA et Dennis D. ADJEI – Juges, et de Robert ENO, Greffier.
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné le « Protocole ») et à la règle 9 (2) du Règlement intérieur de la Cour1 (ci-après désigné « le Règlement »), le Juge Modibo SACKO, de nationalité malienne, s’est récusé.
En l’affaire :
Mamadou DABO et 55 autres
représentés par :
M. Yacouba TRAORÉ, Secrétaire général de la fédération nationale des mines et de l’énergie (FENAME) ; et
Maître Mamadou DIARRA, Avocat au Barreau du Mali.
contre
RÉPUBLIQUE DU MALI
représentée par :
M. Youssouf DIARRA, Directeur général, chargé du contentieux de l’État ; et
M. Ibrahima TOUNKARA, Directeur adjoint, Affaires civiles, commerciales et sociales.
Après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
LES PARTIES
Le sieur Mamadou DABO et 55 autres, (ci-après dénommés « les Requérants »), sont des ressortissants maliens, travailleurs2 de la société Louis Thomson Armstrong Mali SA, (ci-après dénommée « LTA Mali SA »), dont vingt-six (26) syndicalistes sont membres de la Fédération nationale des mines et de l’énergie (FENAME) un syndicat affilié à la Confédération des syndicats des travailleurs du Mali (CSTM). Les Requérants allèguent la violation de droits fondamentaux liés à leur droit d’ester en justice.
La Requête est dirigée contre la République du Mali (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 20 juin 2000. Elle a également, le 19 février 2010, déposé auprès du Président de la Commission africaine, la Déclaration prévue à l’article 34 (6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales.
OBJET DE LA REQUÊTE
Faits de la cause
Il ressort du dossier que le 11 juin 2012, le Comité syndical des travailleurs de LTA Mali SA a déposé un préavis de grève auprès de leur employeur. Dans ledit préavis, ils demandaient la cessation immédiate des procédures de suspension et de licenciement de cinquante-six (56) travailleurs, parmi lesquels vingt-six (26) syndicalistes, le paiement de la majoration salariale de sept pour cent (7 %) pour une période de trente-deux (32) mois et d’une prime de rendement depuis 2011.
Les négociations n’ayant pas abouti, les travailleurs ont, le 19 juin 2012, appelé à une grève du 28 au 29 juin 2012.
À la suite de la grève, le Directeur de LTA Mali SA, par correspondance n° AMS/09/07/2012/HR du 13 juillet 2012, a sollicité l’autorisation de l’Inspection régionale du travail à Kayes (Première Région Administrative du Mali) à l’effet de licencier vingt-six (26) travailleurs dont le Requérant, M. Mamadou Dabo, et tous les membres du Comité Syndical.
En réponse, l’inspecteur régional du travail de Kayes, par courrier n° 0263/DRT-K du 13 juillet 2012, a autorisé le licenciement des vingt-six (26) travailleurs et approuvé la suspension de trente (30) autres.
La FENAME, en réponse à ces mesures, a déposé un préavis de grève de trois (3) jours, du 18 au 20 juillet 2012, au nom des comités syndicaux de LTA Mali S.A. et de la Société d’exploitation des mines d’or de Sadiola (SEMOS) S.A. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de l’État défendeur a été dûment informé de la question par les canaux appropriés.
Afin d’éviter le risque de propagation de la grève à d’autres régions du Mali, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, par décision n° 2012-0192 MTEFP-SG du 28 septembre 2012, a constitué un Conseil d’arbitrage pour résoudre le différend entre LTA Mali S.A. et SEMOS S.A. d’une part et leurs employés affiliés à la FENAME d’autre part, conformément aux articles L.225 et suivants du Code du travail du Mali.
Le 7 janvier 2013, le Conseil d’arbitrage a rendu la sentence n° 001/C.A contenant les conclusions de son arbitrage, et par lesquelles il :
Ordonne à LTA-Mali S.A. de payer aux travailleurs le solde des arriérés de la majoration salariale de 7 % pour une période de trente-deux (32) mois ;
Ordonne à LTA-Mali S.A. de payer aux travailleurs une prime de rendement au titre de l’année 2011, conformément aux dispositions de l’article 8 de la Convention collective des industries géologiques et aquatiques.
Le Conseil d’arbitrage a également ordonné la suspension du mandat d’arrêt émis par la justice malienne contre les quatorze (14) leaders syndicaux.
Dans une correspondance reçue au secrétariat du Conseil d’arbitrage le 1er février 2013, LTA-Mali S.A. a fait opposition à l’exécution de la sentence n° 001/C.A du 7 janvier 2013 du Conseil d’arbitrage.
Par la suite un collectif de travailleurs composé d’Ismaila TRAORÉ et de douze (12) autres, ont saisi le Tribunal du travail de Kayes d’une action contre LTA-Mali S.A. ayant pour objet d’ordonner l’exécution de la décision du Conseil d’arbitrage. Ladite juridiction, dans sa décision n° 015 du 24 juin 2013, s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes de droits et de dommages et intérêts formulées par les plaignants.
Par courrier n° 0039/MTASH/CAB en date du 28 janvier 2014, le ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires de l’État défendeur a enjoint, sans grand succès, à LTA-Mali SA d’exécuter en bonne et due forme la sentence n° 001 du Conseil d’arbitrage.
Le 25 mars 2014, la FENAME a attrait LTA-Mali S.A. en justice à l’effet d’obtenir l’exécution de la sentence du Conseil d’arbitrage, et le 2 juin 2014, le tribunal a rendu un jugement dans lequel il s’est déclaré incompétent en raison de la nature collective du conflit d’une part, et a, d’autre part, jugé que l’action en opposition à exécution de la sentence intentée le 1er février 2013 par LTA-Mali S.A. a rendu celle-ci nulle et de nul effet.
Le 30 juin 2014, les travailleurs bénéficiaires de la sentence, par l’entremise de leur confédération syndicale (la CSTM) ont, par courrier n° 14/00108/CEN-CSTM, demandé au ministre malien du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions, d’intercéder auprès du Conseil des ministres aux fins de l’exécution de la sentence du Conseil d’arbitrage rendue le 7 janvier 2013.
Le 28 octobre 2015, le ministre du Travail, responsable du dossier a présenté une communication écrite qu’il a soumise au Conseil des ministres aux fins de l’exécution de la sentence du Conseil d’arbitrage. Le Conseil des ministres a décidé de ne pas valider ladite communication au motif que les mines ne sont pas un secteur essentiel au sens des normes de l’OIT.
Le 7 janvier 2016, le ministre du Travail, a notifié par courrier n° 000010/MTFP-SG, la décision du Conseil des ministres au Secrétaire général de la Confédération des syndicats des travailleurs du Mali qui l’a transmise à ses syndiqués au nombre desquels figurent les Requérants, Mamadou DABO et autres.
Le 1er novembre 2016, un autre collectif composé de Mamadou DABO et vingt-cinq (25) autres travailleurs, a saisi le Tribunal de la Commune II de Bamako pour réclamer le paiement des montants adjugés par le Conseil d’arbitrage. Dans sa décision n° 145 du 5 avril 2017, cette juridiction s’est déclarée incompétente.
Le 10 janvier 2018, le même collectif de travailleurs a saisi le Tribunal du travail de Bamako d’une autre requête visant à rendre exécutoire la sentence du Conseil d’arbitrage. Le Président dudit tribunal a rendu l’Ordonnance n° 09 du 22 janvier 2018 portant rejet de ladite requête.
Le 9 février 2018, le collectif a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel de Bamako. Au moment de la saisine de la Cour de céans, le recours en appel n’avait pas encore été tranché.
Violations alléguées
Les Requérants allèguent la violation, par l’État défendeur, de leurs droits suivants :
Le droit à ce que leur cause soit entendue, inscrite à l’article 7(1) de la Charte et à l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (ci-après désignée la « DUDH »);
Le droit à la liberté d’association prévu à l’article 11 de la Convention de l’OIT sur la liberté d’association C87 de 1948, les articles 20 et 21 de la Constitution du Mali et les articles 21, L.2313, L.277 du Code du travail du Mali.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
La Requête a été reçue au Greffe le 25 septembre 2017. Le 30 janvier 2018, le Greffe a demandé aux Requérants de lui fournir des informations complémentaires et leur a adressé un courrier de rappel à cet effet, le 2 juillet 2018.
Le 12 juillet 2018, les Requérants ont donné suite à la demande d’informations supplémentaires et ont soumis leurs observations sur les réparations le 27 août 2018.
La Requête a été notifiée à l’État défendeur le 14 août 2018 aux fins de réponse dans les soixante (60) jours, à laquelle il a répondu le 9 octobre 2018.
Les Parties ont déposé leurs conclusions dans les délais prescrits par la Cour et celles de l’une ont été communiquées à l’autre.
Les débats ont été clos le 17 novembre 2020 et les Parties en ont été dûment notifiées.
DEMANDES DES PARTIES
Les Requérants sollicitent de la Cour qu’elle se prononce comme suit :
Dire que l’État défendeur a violé l’article 7(1) de la Charte et l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Dire que l’État défendeur a violé l’article 1 de la Convention C87 de l’OIT, et les articles 20 et 2i de la Constitution du Mali du 25 février 1992.
Les Requérants demandent également à la Cour de :
Condamner l’État défendeur à leur payer le rappel de salaire de juillet 2012 au 31 août 2018 ;
Condamner l’État défendeur à leur payer la somme de quatre-vingts millions (80 000 000) de francs CFA pour le rappel des trente-deux (32) mois restants de 7 % de l’augmentation de 1999 ;
Condamner l’État défendeur à leur payer la somme de quatre milliards (4 000 000 000) de francs CFA au titre de la prime de rendement impayée ;
Condamner l’État défendeur à payer la somme de six millions (6 000 000) de francs CFA à chaque salarié à titre de dommages-intérêts ;
Ordonner à l’État défendeur de diligenter l’exécution provisoire de de la moitié des droits ;
Ordonner à l’État défendeur de délivrer des certificats de travail pour chaque ex-travailleur ;
Condamner l’État défendeur à payer aux travailleurs une astreinte de quatre millions (4 000 000) de francs CFA par personne et par jour de retard, à compter du prononcé de la décision ;
Condamner l’État défendeur aux dépens.
L’État défendeur demande, quant à lui, à la Cour de :
Déclarer la Requête irrecevable.
À titre subsidiaire, l’État défendeur demande à la Cour de :
Rejeter la Requête au motif qu’elle est dépourvue de tout fondement ;
Mettre les frais de procédure à la charge des Requérants.
SUR LA COMPÉTENCE
La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du [...] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement »4.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour est tenue de procéder, à titre préliminaire, à l’examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions qui s’y rapportent.
La Cour constate que l’État défendeur ne soulève aucune exception d’incompétence en l’espèce. Néanmoins, elle doit s’assurer que tous les aspects de sa compétence sont satisfaits avant de poursuivre l’examen de la Requête.
S’agissant de sa compétence matérielle, la Cour relève que les Requérants allèguent la violation de l’article 7(1) de la Charte, l’article 8 de la DUDH et l’article 11 de la Convention de l’OIT sur la liberté d’association C87 de 1948. La Cour rappelle que l’État défendeur est partie à la Charte et que la DUDH représente le droit international coutumier qui lie automatiquement les États.
La Cour note, en ce qui concerne sa compétence personnelle, que celle-ci est établie dans la mesure où l’État défendeur est partie à la Charte et au Protocole et a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) en vertu de laquelle les individus et les organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme peuvent la saisir directement.
S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que toutes les violations alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole et a déposé la Déclaration. La Cour en conclut que sa compétence temporelle est établie.
La Cour relève, en ce qui concerne sa compétence territoriale, que les violations alléguées par les Requérants se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. Par conséquent, sa compétence territoriale est établie.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête.
SUR LA RECEVABILITÉ
En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ».
Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au présent Règlement ».
La règle 50(2) du Règlement5, qui reprend en substance les dispositions de l’article 56 de la Charte, dispose comme suit :
Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après :
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ;
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ;
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ;
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ;
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte.
La Cour relève qu’en l’espèce l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va dès lors se prononcer sur ladite exception (A) avant d’examiner les autres conditions de recevabilité (B) si nécessaire.
Exception tirée du non-épuisement des recours internes
L’État défendeur soutient que les Requérants n’ont pas épuisé les recours internes qui leur étaient disponibles. Il fait valoir que les recours internes relatifs à la demande de réparation formulée par Ismaila TRAORÉ et douze (12) autres travailleurs ont été épuisés au niveau du tribunal de Kayes avec le jugement n° 015 du 24 janvier 2013. Lesdits travailleurs n’ont pas interjeté appel de cette décision. L’État défendeur fait valoir qu’on ne saurait blâmer ses services publics du fait que les Requérants n’aient pas exercé les recours en appel puis en cassation qui leur étaient disponibles. Il soutient donc que la Requête est irrecevable et qu’elle devrait être rejetée.
L’État défendeur fait en outre valoir que l’action intentée le 25 mars 2014 par la FENAME aux fins de confirmation de la sentence arbitrale n° 001/CA du 7 janvier 2013 rendue par le Conseil d’arbitrage et contestée par L.T.A. Mali S.A., sur laquelle le Tribunal de travail de Bamako s’est prononcé par décision n° 154 du 2 juin 2014, n’a pas été portée devant la plus haute juridiction en matière de procédure civile. Il en est ainsi, selon lui, parce qu’après avoir été déboutés en première instance, les Requérants n’ont pas exercé les recours qui leur sont ouvert par le Code de procédure civile du Mali. Selon lui, il était pourtant dans leur intérêt de porter leur affaire, jusque devant la Cour suprême du Mali en vue d’obtenir satisfaction. Il affirme que les Requérant s’étant abstenus de se pourvoir devant la Cour suprême, ceux-ci ne sauraient tenir l’État défendeur pour responsable d’une quelconque violation de leur droit à la justice.
L’État défendeur explique, en outre, que le collectif des travailleurs de L.T.A. Mali S.A. composé de Mamadou DABO et vingt-cinq (25) autres ont saisi le Tribunal civil de la Commune II de Bamako le 1er novembre 2016, à l’effet de faire exécuter le paiement des droits qui leur ont été adjugés. Ladite action a été tranchée par jugement n° 45 du 5 avril 2017 déclarant ledit tribunal incompétent et les Requérants n’ont pas porté leur affaire plus loin.
L’État défendeur affirme que les mêmes Requérants ont saisi la Cour d’appel de Bamako le 9 février 2018 d’un recours en appel du jugement n° 09 du 22 janvier 2018 rendu par le Tribunal de travail après avoir introduit leur Requête devant la Cour de céans le 21 août 2017. La présente Requête est donc irrecevable dans la mesure où les recours internes n’ont pas été épuisés.
L’État défendeur soutient également que la réticence des Requérants à contester les décisions6 de l’Inspecteur régional du travail de Kayes devant les juridictions administratives nationales démontre à suffisance qu’ils n’ont pas épuisé tous les recours internes qui leur étaient disponibles avant de saisir l’honorable Cour de céans.
L’État défendeur affirme, par ailleurs, que toutes les affaires portées devant les juridictions internes ont, à ce jour, été jugées dans un délai raisonnable. Selon l’Etat défendeur, les affaires introduites depuis 2013, ont toutes été tranchées en l’espace de deux (2) ans, voire moins. Toutefois, la plupart des procédures sus-évoquées ne sont pas allées au-delà du stade de la première instance. L’affaire portée par Ismaila TRAORÉ et autres devant le Tribunal de travail de Kayes en 2013 a été tranchée par le jugement n° 15 rendu le 24 juin 2013. Quant à la seconde affaire, intentée par la FENAME devant le Tribunal de travail de Bamako, elle a été ouverte le 25 mars 2014 et tranchée par jugement n° 154 rendu le 2 juin 2014 par ladite juridiction.
Selon l’Etat défendeur, la troisième affaire, introduite par Mamadou DABO et vingt-cinq (25) autres devant le Tribunal civil de la Commune II de Bamako, a débuté le 1er novembre 2016 et ledit tribunal l’a tranchée par jugement n° 145 rendu le 5 avril 2017. La quatrième affaire a été introduite le 10 janvier 2018 devant le Président du Tribunal de travail de Bamako par Mamadou DABO et vingt-cinq (25) autres en vue d’obtenir une décision rendant exécutoire la sentence du Conseil d’arbitrage. Le Président du Tribunal a examiné l’affaire et l’a rejetée le 22 janvier 2018, quelques jours seulement après son dépôt.
L’État défendeur fait valoir que les dirigeants syndicaux, qui affirment avoir été injustement licenciés, n’ont pas intenté d’action afin de prouver leurs allégations de licenciement arbitraire et demander leur réintégration dans leur entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2777 du Code du travail. Ils ont au contraire préféré introduire des requêtes aux fins de paiement de leurs droits et d’obtention d’une décision de justice rendant exécutoire la sentence du Conseil d’arbitrage.
Enfin, l’État défendeur affirme que la réticence dont les Requérants ont volontairement fait preuve en n’engageant pas d’action contre les décisions8 de l’Inspecteur régional du travail de Kayes devant les instances judiciaires nationales chargées du contentieux administratif est la preuve incontestable que tous les recours internes qui leur étaient disponibles n’ont pas été épuisés avant la saisine de la Cour de céans.
*
En réponse, les Requérants soutiennent que les recours internes sont indisponibles et inefficaces dans la mesure où au moment de l’ouverture de la procédure, les lois du Mali ne reconnaissaient pas compétence aux tribunaux pour faire exécuter les sentences arbitrales rendues dans les conflits impliquant des collectifs de travailleurs. La sentence arbitrale a été révoquée après qu’elle a été rejetée par le Conseil des ministres, seul organe habilité à rendre la décision exécutoire.
Ils indiquent, toutefois, que même après avoir exercé ce recours, ils ont saisi le Tribunal du travail de Bamako à l’effet d’obtenir l’exécution de ladite sentence arbitrale et ont été déboutés. Les Requérants affirment que plus aucune voie de recours judiciaire ne leur était ouverte pour obtenir justice. Ils ont interjeté appel de la décision du Tribunal du travail de Bamako devant la Cour d’appel de Bamako il y a plus de huit mois, une procédure qui est toujours pendante.
***
La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte, qui reprend en substance la règle 50(2)(e) du Règlement, les requêtes soumises devant elle doivent satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction avant qu’un organe international de défense des droits de l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard9.
La Cour rappelle que les recours internes à épuiser sont des recours ordinaires, à moins que la procédure y relative se prolonge de façon anormale. La Cour entend donc s’assurer qu’en l’espèce, les Requérants ont épuisé les recours internes.
Il ressort du dossier devant la Cour que les Requérants ont engagé des procédures devant les tribunaux de l’État défendeur, étant constitués en trois collectifs.
S’agissant du premier collectif, la FENAME, elle a intenté le 25 mars 2014, un procès contre LTA-Mali S.A. à l’effet d’obtenir l’exécution de la sentence arbitrale. Le 2 juin 2014, la Cour, se prononçant sur l’affaire, s’est déclarée incompétente au motif que le litige avait un caractère collectif et que LTA-Mali S.A. avait déposé, le 1er février 2013, une déclaration d’opposition ayant un effet suspensif sur la sentence arbitrale.
En ce qui concerne le deuxième collectif de travailleurs, Ismaila TRAORÉ et douze (12) autres travailleurs, ils ont intenté une action contre LTA-Mali S.A. devant le Tribunal de travail de Kayes. Ladite juridiction, dans sa décision n° 015 du 24 juin 2013, s’est déclarée incompétente pour examiner leurs demandes.
Le 1er novembre 2016, le troisième collectif, composé de Mamadou DABO et de vingt-cinq (25) autres personnes, a saisi le Tribunal civil du district de Bamako Commune II pour réclamer les montants adjugés par le Conseil d’arbitrage. Dans son jugement n° 145 du 5 avril 2017, le Tribunal civil s’est également déclaré incompétent pour examiner leurs demandes. Le même collectif de travailleurs, Mamadou DABO et vingt-cinq (25) autres ont porté à nouveau l’affaire devant le Tribunal de travail de Bamako en vue de rendre exécutoire la décision du Conseil d’arbitrage. Le Président de ladite juridiction a rejeté l’affaire par ordonnance n° 9 rendue le 22 janvier 2018. Le 9 février 2018, les travailleurs ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Bamako qui, au moment du dépôt de la Requête devant la Cour de céans, n’avait toujours pas tranché l’affaire.
La Cour relève que le 1er février 2013, LTA-Mali S.A. a notifié au greffe du Conseil arbitral son opposition à l’exécution de la décision du Conseil d’arbitrage n° 001/C.A. du 7 janvier 2013, dans les délais réglementaires, suspendant ainsi la sentence conformément à l’article 229 de la loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail au Mali10.
La Cour de céans relève également que l’État défendeur a promulgué la loi n° 021-2017 du 12 juin 2017 portant modification de la loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 sur le Code du travail du Mali dont l’article L.229 nouveau11 ouvre une voie de recours contre la décision du Conseil d’arbitrage devant la Chambre sociale de la Cour suprême en cas d’excès de pouvoir, de violation de la loi ou de violation des règles de procédure. Ledit article précise également les cas dans lesquels les sentences arbitrales peuvent être annulées. La Loi a été publiée au Journal officiel de l’État défendeur à la même date, soit bien avant que les Requérants ne saisissent la Cour de céans de la présente Requête le 25 septembre 2017.
La Cour note que les Requérants l’ont saisie de leur Requête le 25 septembre 2017, soit après la promulgation de la nouvelle loi, par conséquent, les Requérants n’avaient pas épuisé les recours internes.
La Cour conclut que la Requête ne satisfait pas à la condition de recevabilité prévue à la règle 50(2)(e) du Règlement et à l’article 56(5) de la Charte, accueille l’exception soulevée par l’État défendeur et déclare, en conséquence, la Requête irrecevable.
Autres conditions de recevabilité
Ayant conclu que la présente Requête ne satisfait pas à l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement et au regard du caractère cumulatif des conditions de recevabilité12, la Cour estime qu’il est superfétatoire de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité prévues à la règle 50(2)(a), (b), (c), (d), (f) et (g) du Règlement13.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
Les Requérants demandent à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge de l’État défendeur.
L’État défendeur demande, quant à lui, à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge des Requérants.
***
La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2)14, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
La Cour décide, en l’espèce, que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité,
Sur la compétence
Dit qu’elle est compétente.
Sur la recevabilité
Reçoit l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes ;
Déclare la Requête irrecevable.
Sur les frais de procédure
Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Imani D. ABOUD, Présidente ;
Blaise TCHIKAYA, Vice-président ;
Ben KIOKO, Juge ;
Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ;
Suzanne MENGUE, Juge ;
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ;
Chafika BENSAOULA, Juge ;
Stella I. ANUKAM, Juge ;
Dumisa B. NTSEBEZA, Juge ;
Dennis D. ADJEI, Juge ;
et Robert ENO, Greffier.
Fait à Arusha, ce premier jour du mois de décembre de l’an deux mille vingt-deux, en arabe, en anglais et en français, le texte français faisant foi.

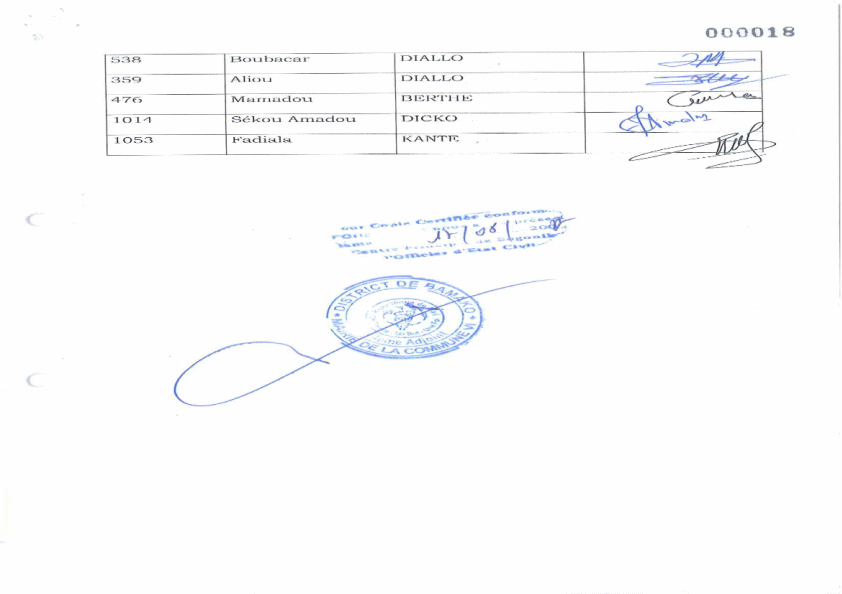
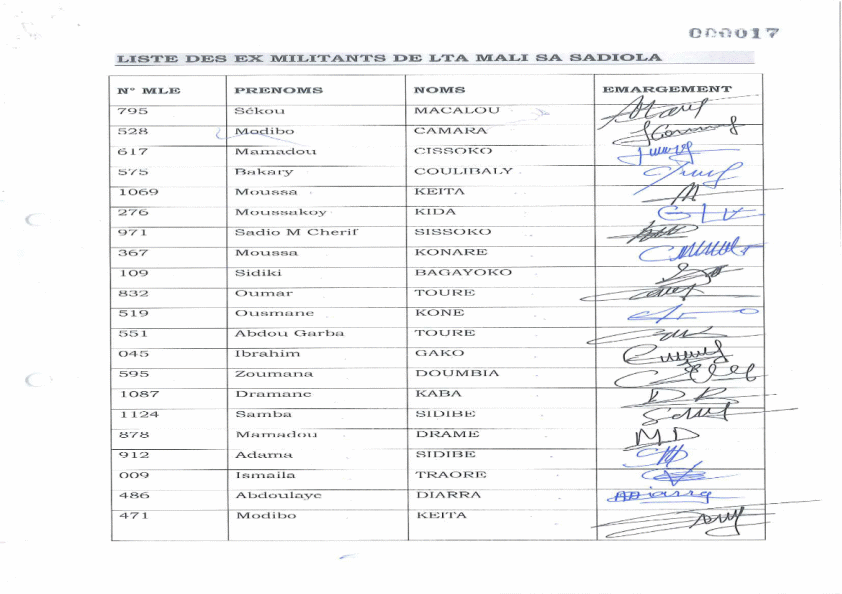

1 Article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
2 Voir la liste des travailleurs en annexe.
3 L’État défendeur est devenu partie à la Convention de l’OIT sur la liberté d’association de 1948 en 1960.
4 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
5 Article 40 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
6 Références n°s 0263/DRT-K du 13 juillet 2012 et 0348/DRT-K du 24 août 2012
7 Article L.277 : L’autorisation de l’inspecteur du travail est requise, avant tout licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l’employeur ou son représentant. L’autorisation ou le refus de cette autorisation doit être notifié à l’employeur ou au délégué du personnel concerne’. Le défaut de réponse de l’inspecteur du Travail dans les quinze (15) jours du dépôt de la demande vaut autorisation de licenciement, sauf dans les cas où l’inspecteur du Travail juge qu’une expertise est nécessaire. Dans ce cas, le délai est à 30 jours et l’inspecteur doit informer par écrit l’employeur, avant l’expiration des 15 jours, de sa décision de prolonger le délai.
Tout licenciement intervenu en violation de la procédure prévue à l’alinéa précédent est nul de plein droit et le délégué est rétabli dans ses droits et réintégré dans l’entreprise.
Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus d’autorisation de licenciement, la mise à pied est privée de tout effet.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux travailleurs candidats aux fonctions de délégués pendant la période comprise entre la date d’affichage des listes et celle du scrutin, ainsi qu’aux délégués élus jusqu’à la date des nouvelles élections et pendant une période de 6 mois consécutive à l’expiration du mandat du délégué.
8 Réf. n°s 0263/DRT-K du 13 juillet 2012 et 0348/DRT-K du 24 août 2012
9 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, §§ 93 à 94.
10 Article 229 : La décision du conseil d’arbitrage est immédiatement notifiée et commentée aux parties par le président du conseil d’arbitrage.
Si dans les 8 jours francs suivant cette notification aux parties, aucune de celles‐ci n’a manifesté son opposition, la décision acquiert force exécutoire.
Pour les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale, ou intéressant un secteur vital des professions, le Ministre chargé du travail en cas de désaccord de l’une ou des deux parties, porte le conflit devant le conseil des Ministres qui peut rendre exécutoire la décision du conseil d’arbitrage.
11 Article L.229 nouveau : Le Conseil d’arbitrage dispose d’un délai de 15 jours pour rendre sa sentence. La décision du Conseil est immédiatement notifiée et commentée aux Parties par le Président qui en adresse une copie au ministre chargé du Travail. La formule exécutoire est apposée sur la décision du Conseil, par ordonnance du Président du tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente. La sentence arbitrale ne peut faire l’objet de recours que pour excès de pouvoir, violation de la loi ou violation des règles de procédure, portés devant la chambre sociale de la Cour suprême. Le recours en annulation de la sentence arbitrale est ouvert : si le conseil d’arbitrage a été régulièrement constitué ; si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui a été assignée ; s’il a violé une règle d’ordre public ; lorsque le principe du débat contradictoire n’a pas été respecté. Le recours doit être exercé dans les 8 jours francs suivant la signification de la sentence. Il est suspensif de l’exécution de la sentence arbitrale. En cas d’annulation de tout ou partie de la sentence arbitrale, la Cour Suprême, dans le délai de trois jours francs suivant la date de sa saisine par la partie la plus diligente, renvoie l’affaire aux parties qui proposent au ministre chargé du Travail, la constitution d’un nouveau conseil d’arbitrage. Dans le cas où la nouvelle sentence est annulée, la Cour Suprême rend, dans les 15 jours suivants le 2e arrêt d’annulation, avec les mêmes pouvoirs qu’un arbitre, une sentence qui ne peut faire l’objet d’aucun recours.
12 Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 2018) 2 RJCA 246, § 63 ; Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018) 2 RJCA 373, § 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du Mali (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA 77, § 38.
13 Ibid.
14 Article 30(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
1

